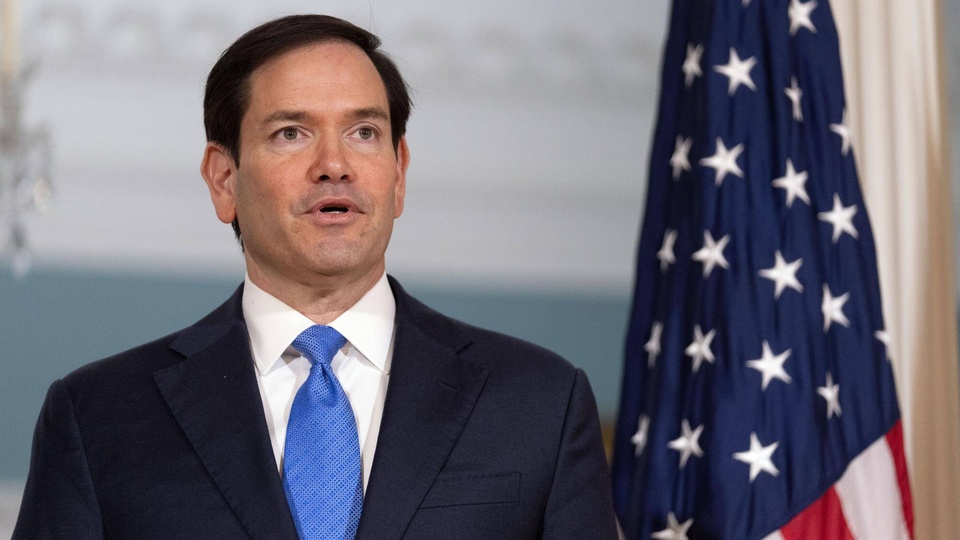Le Département d’État américain a publié avant-hier son rapport annuel sur les droits humains au Sénégal, saluant une année marquée par l’organisation d’une présidentielle jugée libre et équitable et par la libération de tous les prisonniers politiques. Mais derrière ces avancées, le document pointe de graves lacunes : violences policières impunies, arrestations arbitraires, détentions prolongées, restrictions persistantes à la liberté d’expression et conditions de travail précaires. De la gestion des manifestations à la protection des femmes et des enfants, en passant par les droits syndicaux et l’accueil des réfugiés, Washington brosse un portrait contrasté d’un pays qui conjugue crédibilité électorale retrouvée et chantiers démocratiques inachevés.
Le rapport 2024 du Bureau de la démocratie, des droits humains et du travail du Département d’État américain, publié avant-hier, arrive dans un Sénégal marqué par une année électorale décisive. Après trois années de tensions politiques, ponctuées de manifestations parfois meurtrières, le pays a organisé en mars une présidentielle saluée par Washington comme «libre et équitable», sans irrégularités majeures. Un scrutin qui, selon le document, a permis une détente politique symbolisée par la libération de tous les prisonniers politiques en fin d’année.
Liberté d’expression : garanties constitutionnelles, pratiques restrictives
Mais ce satisfecit est rapidement nuancé : «des problèmes importants persistent», écrit le Département d’État, citant «le recours à des traitements cruels ou dégradants, des arrestations arbitraires, et des restrictions sérieuses à la liberté d’expression et de la presse».
Si la Constitution sénégalaise garantit la liberté d’expression, le rapport souligne que celle-ci est régulièrement mise à mal par des lois pénales prévoyant des sanctions pour diffamation et offense au chef de l’État. Ces dispositions, largement utilisées, ciblent aussi bien des opposants politiques que des journalistes.
En juillet 2024, un membre de l’opposition est arrêté pour avoir affirmé que des responsables du parti au pouvoir avaient «menti pour accéder au pouvoir». Deux mois plus tard, c’est l’ancien commissaire de police Cheikhna Keita qui est interpellé pour «diffusion de fausses nouvelles» après avoir évoqué un différend présumé entre le président et le Premier ministre. Amnesty International dénonce alors une «restriction injustifiée à la liberté d’expression» et réclame une réforme législative.
Les journalistes ne sont pas épargnés. Le Comité pour la protection des journalistes (Cpj) relève que plus de 25 reporters ont été agressés ou arrêtés lors des troubles de février, consécutifs à l’annonce du report de l’élection présidentielle. Les cas de Kader Dia et Cheikh Yerim Seck, interpellés à l’automne pour des propos critiques sur la police et le gouvernement, illustrent cette tendance.
Les médias subissent aussi des mesures administratives directes. Le 5 février, la chaîne privée Walfadjri TV se voit retirer sa licence pour «diffusion d’images violentes» et «langage subversif», avant de la récupérer quelques jours plus tard.
Arrestations arbitraires et détentions prolongées : la loi et la pratique
Officiellement, la législation sénégalaise interdit les arrestations arbitraires et garantit la présentation rapide des suspects devant un juge. Dans les faits, note le rapport, la police interprète largement la notion de flagrant délit, ce qui lui permet de procéder à des arrestations sans mandat, notamment lors des manifestations politiques.
Les délais de garde à vue peuvent être prolongés jusqu’à 96 heures pour les infractions graves, et jusqu’à 12 jours pour les affaires de terrorisme. Amnesty International dénonce des «détentions officieusement prolongées» par un artifice juridique : la garde à vue ne débute officiellement qu’une fois déclarée, ce qui retarde l’accès des avocats et accroît les risques d’abus.
Les détentions provisoires dépassent souvent les six mois prévus pour les délits mineurs. Les lenteurs judiciaires, les absences de magistrats et l’engorgement des tribunaux font que certains prévenus passent plus de temps en prison avant leur procès que la peine finalement prononcée. Cette situation touche particulièrement les personnes arrêtées lors des manifestations de 2024, dont plusieurs mineurs privés d’assistance juridique.
Violences policières, torture et impunité : un triple défi
La loi sénégalaise interdit la torture et les traitements cruels ou dégradants. Pourtant, de «nombreux cas crédibles» de mauvais traitements sont documentés par les Ong : coups de matraque, privation de sommeil, cellules sans aération, interrogatoires musclés.
L’année 2024 a été marquée par deux affaires emblématiques. Le 5 février, trois personnes meurent lors de manifestations contre le report de la présidentielle. Impossible, à ce jour, de déterminer si elles ont succombé aux tirs des forces de l’ordre, à des violences de manifestants ou à d’autres causes. En juin, un jeune homme décède après avoir été battu dans un camp militaire de Dialadiang ; l’enquête est toujours en cours.
En mars, l’Assemblée nationale adopte une loi d’amnistie pour toutes les infractions liées aux manifestations politiques de février 2021 à février 2024. Si cette mesure visait principalement à apaiser les tensions et libérer les détenus politiques, les Ong soulignent qu’elle a aussi effacé d’éventuelles responsabilités pénales de membres des forces de l’ordre impliqués dans des abus.
Droits syndicaux et conditions de travail : protections légales, exclusions massives
Les travailleurs du secteur formel bénéficient de droits syndicaux et de négociation collective, mais certaines professions – juges, douaniers, personnels administratifs – sont exclues. Les procédures de création et de reconnaissance d’un syndicat sont lourdes, et le ministre de l’Intérieur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser l’enregistrement, même si cela est rare.
Le droit de grève est encadré : préavis d’un mois, interdiction d’occuper les lieux de travail, possibilité pour l’État de réquisitionner les grévistes. La loi autorise les sanctions, y compris le licenciement, pour participation à une grève jugée illégale.
Sur le plan des conditions de travail, la législation fixe un salaire minimum supérieur au seuil de pauvreté, limite la durée hebdomadaire du travail à 40 heures dans le non-agricole et impose des normes de sécurité. Mais le secteur informel, où se concentre 90% de l’emploi, échappe totalement à ces règles. Les inspecteurs du travail, au nombre de 200 pour tout le pays, privilégient la médiation aux sanctions, réduisant l’effet dissuasif des contrôles.
Droits des femmes et des enfants : des lois peu appliquées
Le Sénégal interdit la mutilation génitale féminine, mais aucune poursuite n’a été engagée en 2024. Selon l’Unicef, une femme sur quatre âgée de 15 à 49 ans est concernée, avec des pics à 90% dans certaines régions.
Le mariage des mineures, prohibé avant 16 ans pour les filles, reste courant dans les zones rurales. Les juges peuvent accorder des dérogations, et les mariages arrangés échappent souvent à tout contrôle. Les campagnes de sensibilisation menées par le ministère de la Famille et les Ong peinent à modifier des pratiques profondément ancrées.
Le rapport note la coopération du Sénégal avec le Haut-Commissariat aux réfugiés pour accueillir notamment les Mauritaniens présents depuis les années 1980 dans la vallée du fleuve Sénégal. Beaucoup sont intégrés socialement et économiquement, mais l’accès à la citoyenneté reste freiné par des lourdeurs administratives.
Sur le plan des minorités religieuses, le document indique qu’aucun incident antisémite n’a été rapporté dans une communauté juive estimée à une centaine de personnes.
En définitive, le rapport du Département d’État américain confirme que le Sénégal conserve des atouts démocratiques rares dans la région : alternance politique, société civile active, relative liberté des médias. L’élection présidentielle de mars 2024 et la libération des prisonniers politiques ont permis d’amorcer un climat d’apaisement.
Mais les critiques de Washington, déjà formulées les années précédentes, persistent : usage excessif de la force par les forces de sécurité, restrictions à la liberté d’expression, lenteurs judiciaires, impunité des abus. Si l’État veut consolider son image de démocratie stable, il devra aller au-delà des gestes symboliques et réformer en profondeur ses lois et pratiques.
Sidy Djimby NDAO
(Correspondant permanent en France)